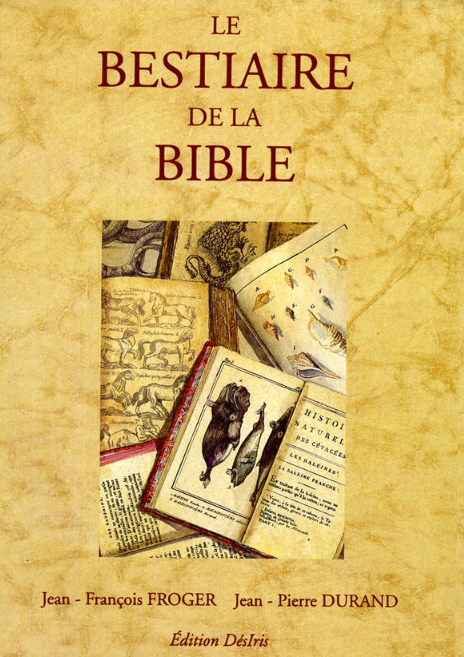
Le Bestiaire de la Bible – Jean-François Froger, (éditions DésIris -1994)
Recension – Marion Duvauchel
A la mémoire de Jean-Pierre Durand
Pendant longtemps, le terme « hapax » a qualifié les mots ou expressions impossibles à traduire de façon certaine parce qu’il n’en existe qu’une seule occurrence dans la littérature disponible. Par analogie, le Bestiaire de la Bible est un « hapax ». Il n’existe qu’un seul ouvrage de ce type dans l’abondante littérature qui traite de ce qu’on appelle le « symbolisme » terme aussi flou que la littérature sur le sujet : depuis les dictionnaires des symboles de toutes obédiences (emblèmes, attributs, symboles maçonniques) jusqu’à la psychanalyse la plus absconse (L’homme et ses symboles de Jung). Tous ces ouvrages généralement liés à la question des mythes, des rêves, des coutumes, maintiennent l’idée (aussi vague soit-elle) d’une connaissance accessible par le biais des symboles. Mais cette connaissance trouve son ancrage principal dans le champ de l’imaginaire.
Ecrit à deux mains, celles des deux esprits complices et complémentaires du bibliste et du zoologiste, on quitte avec ce livre le « symbolisme » pour entrer dans la fonction symbolique, fonction centrale dans une saine théorie de la connaissance. Elle viendra d’ailleurs, dans des ouvrages plus tardifs de l’auteur. Mais d’ores et déjà, il a semé dans chacun des chapitres, tout un jeu de clés qui dessinent une route, un chemin de connaissance. Formellement, on compte trente-six chapitres, mais d’animaux on en compte bien plus, car il faut compter les quaternités d’animaux, ceux qui vont un petit peu ensemble zoologiquement, ceux dont on ne soupçonnerait pas qu’ils appartiennent au genre animal, comme l’éponge, associée au fait « de retrouver la puissance des petits-enfants ». Qui n’en a pas rêvé ?
Le Bestiaire s’adresse à tous ceux qui pensent que l’homme ne se nourrit pas seulement d’équations mathématiques, de loisirs pas chers et de découvertes majeures sur Tik Tok. Ceux qui pensent ou sentent que la vie de l’homme ne s’enracine pas seulement dans la raison pure ou calculante, mais que l’homme entretient avec les choses du monde un rapport privilégié, qu’on appellera « symbolique » parce qu’il est commode de pouvoir nommer les choses dont on parle et qu’il est mieux encore de comprendre la réalité que le mot recouvre. Ce livre (illustré) ne peut qu’intéresser ceux qui désespèrent de la raison ou de la froide abstraction. Il y en a. Et parce qu’il draine aussi des années de patiente exégèse et une connaissance anthropologique aussi large que profonde, il s’adresse aussi à ceux qui ne trouvent pas une nourriture substantielle dans les bavardages théologiques. Car correctement entendu, le symbole est l’une des deux ailes de la connaissance : l’analogie. L’autre est la logique et elles ne sont pas concurrentes : on ne vole pas avec une seule aile. Voir sur ce point le chapitre sur l’aigle.
Jean-François Froger affiche d’emblée l’ambition qui soutient son ouvrage : « il y a une véritable science du symbole (…) une connaissance qui s’établit expérimentalement, selon des procédures convenables (qui conviennent) à ce sujet particulier d’étude ».
Et cette procédure commence par une connaissance réelle de la chose réelle : le lion réel, le taureau réel, l’aigle réel, les oiseaux du ciel réels, le cochon réel… Parce qu’il faut la connaissance réelle de l’animal étudié, chaque objet d’étude bénéficie de deux approches : d’une part celle du zoologue (Jean-Pierre Durand) qui fournit la notice zoologique savante et d’autre part l’analyse proprement symbolique qui intègre des aspects exégétiques, des questions relevant de la métaphysique ou de la théologie – pour construire précisément des analogies sûres. Car le ressort de la fonction symbolique, c’est l’analogie.
Il faut saluer le travail du zoologiste et l’ensemble de ces notices réalisées par Jean-Pierre Durand qui constituent une micro-encyclopédie de nos amies les bêtes.
On a dit et répété à l’envi que si le monde hébraïque privilégie les images, c’est parce qu’il s’agit d’une société « traditionnelle » de gens qui possédaient des troupeaux et vivaient sous des tentes en contact avec la nature. Ils connaissaient de près les scorpions, les serpents, les agneaux et tout un bestiaire qu’on retrouve dans l’Ancien Testament. Ça n’est pas complètement idiot mais c’est loin d’être satisfaisant. La contingence historique n’explique pas tout, et surtout pas l’essentiel, à savoir la notion même de Création et le texte qui donne les clés d’intelligibilité de la nature humaine : la Genèse. Si les animaux défilent devant Adam qui doit les nommer, c’est qu’ils président à la naissance du langage.
Ces choses du monde que l’on trouve dans les Ecritures (et dans le monde sensible qui est le nôtre) figurent des réalités intelligibles ; elles sont, dans la contingence, des formes qui existent en nous, dont le sens intelligible est porté par ces créatures que nous appelons les anges. Le protocole est précis, il demande du temps, de la patience, de la discipline (il est décrit dans des ouvrages plus tardifs, Structure de la connaissance avec le regretté Robert Lutz, mais aussi dans Enigme de la pensée). Car de même qu’il est « convenable » que les interprétations symboliques soient fondées en réalité, (les objets réels et non les formes mythologiques qui les véhiculent) il est convenable « de lire attentivement les Ecritures pour préserver l’exactitude des images concrètes dont se sert le texte pour signifier son sens ». La fonction symbolique requiert rigueur et précision.
Que figurent donc ces animaux que la Bible évoque ou mentionne ? La préface de Michel-Gabriel Mouret se présente comme une sorte de « bande-annonce » : ils sont, écrit-il, une « métaphore des mécanismes psychobiologiques dont l’homme ne maîtrise pas l’émergence (…) mais qu’il peut intégrer dans une alliance de conscience ». Cette alliance est la première des actions de Dieu au long de l’histoire. C’est l’alliance avec Noé, ce patriarche qui construit une arche pour y intégrer toutes les espèces animales et éviter qu’elles ne soient détruites sous les eaux du déluge. La leçon symbolique est claire : l’homme n’est pas un animal mais il contient en lui la totalité du monde animal. C’est aujourd’hui une réalité largement effacée et remplacée par le mythe de notre parenté avec les primates.
Les animaux décrivent donc « (par les analogies réelles tirées de leurs caractéristiques zoologiques), la vie de la psyché humaine en son contact avec le corps et l’esprit ». Ils nous informent donc en profondeur. C’est pourquoi le premier chapitre décrit les Quatre Vivants, (les quatre Evangélistes) et les animaux qui leur sont associés : le lion de Marc, le taureau de Luc, l’aigle de Jean. (Matthieu n’a pas de représentant animal). Ils décrivent un parcours, un passage, une transformation : celle de l’homme psychique en l’homme spirituel. C’est le programme.
L’ouvrage fait ainsi découvrir le sens du dragon énorme, du grand poisson, du lézard, de la fourmi, des sauterelles dont se nourrissait Jean le Baptiste, de la panthère qui figure le « Tout animal » et de bien d’autres. Chaque titre est de soi une piste donnée au lecteur. L’araignée invite à considérer en tremblant la liberté angélique. Il y a « nombre et nombres » coassent les grenouilles et si le renard est si malin, c’est parce qu’il évite les pièges qui lui sont tendus. Oui, mais le lion aussi, qui dévore la gazelle.
Elle est l’emblème de l’élégance ! Qui pourrait y demeurer insensible ? Le symbolisme de la gazelle se comprend à partir du Cantique des Cantiques et dans une quaternité : antilope -gazelle-oryx–chamois. Et c’est ainsi qu’en quelques pages le lecteur est initié à ce terme mystérieux de la théologie : l’épectase. Le désir du Beau qui nous entraîne sans cesse et qui ne cesse de s’étendre. On trouve une version grecque de ce symbolisme dans Le mythe d’Eros et Psyché dans une nouvelle traduction de Bernard Verten, du même auteur.
Avec les oiseaux du ciel nous apprenons qu’il ne faut pas introduire de calcul dans les processus d’inspiration et avec le lézard l’importance de la distinction entre le pur et l’impur.
Ceux qui, comme moi, connaissent un peu les arguties des Scolastiques savent que Duns Scott et Thomas d’Aquin se sont chamaillés sur la question du principe d’individuation. Ils l’ont fait dans une langue technique un peu obscure, voire ardue, pour ne pas dire rébarbative, au moins pour ceux qui ne disposent pas du temps et de la patience nécessaire. Duns Scott s’est même fendu d’un livre intitulé Le principe d’individuation. C’est de la haute métaphysique sur fond de discussion théologique.
Ô merveille, cette métaphysique devient accessible à partir du cochon. Cela mérite d’être souligné et c’est pourquoi il est l’animal tout choisi pour donner un coup de projecteur sur la question (philosophique) de la liberté humaine. L’auteur rappelle d’abord un point essentiel : « les parents ne font que communiquer les conditions charnelles de l’existence, non la vie même de l’âme. Ils communiquent l’espèce, non l’individu. L’homme ne possède pas en lui-même son principe d’individuation. Il faut qu’il veuille son unité selon un principe qu’il doit choisir délibérément. Il peut choisir de s’individuer dans son groupe naturel, un peu comme un animal : disons sa famille (restreinte ou élargie), sa tribu, sa secte, sa « Oumma », son groupe d’appartenance comme disent les sociologues, ses copains d’abord. Il peut aussi s’individuer selon une divinité parce qu’il entre en contact avec un archétype qui le subjugue ». Prolongeons… Il devient sectateur, gourou ou illuminé. Toutes les pratiques occultistes mettent ainsi en contact avec ces « archétypes », entendez « démons ». L’homme peut aussi refuser tout principe d’individuation comme le bouddhisme semble y prétendre. Ce n’est qu’illusion car le bouddhiste s’individue selon la divinité qu’on appelle le Bouddha. Voilà qui pourrait nous éclairer par ailleurs sur le principe d’individuation dans des sociétés aussi inégalitaires que l’islam où il est interdit de choisir son principe d’individuation.
Ce qui fait que je suis « moi », c’est d’abord bien sûr que je suis fils de… (fille de…). C’est le début de la construction humaine et un conditionnement inévitable. C’est aussi le choix radical du chrétien. « L’homme peut aussi renoncer à construire sa propre hypostase humaine et choisir de s’individuer en recevant en lui-même le Verbe divin, pour être adopté comme Fils de Dieu ». Voilà qui éclaire un dogme fondamental du christianisme : l’Incarnation.
Sans l’Incarnation (du Verbe), cette individuation serait impossible et les hommes ne pourraient que servir de suppôt aux démons ou construire une individuation purement humaine, injuste en sa racine ». Entre la brute animale ou la satanisation… Car cette individuation humaine est source de cette surenchère que l’on ne connaît que trop dans la société humaine et qui s’affirme dans la soif de prestige, d’argent de pouvoir, d’apparat ou tout autre idole à laquelle l’homme s’est soumis. C’est la structure mimétique mise en évidence par René Girard. Choisir le Christ, c’est renoncer à construire son « moi » et ses étayages les plus divers, ses fictions, ses illusions et le besoin de se prévaloir d’être le meilleur, la plus belle, le plus doué etc…
Pourquoi donc le porc est-il considéré comme un animal impur ? Manger de la chair de porc, dit l’auteur, » est compris dans une série d’actes qui ont pour objet le culte des esprits mauvais ». Pourquoi donc les démons quittent le corps du possédé pour entrer dans un troupeau de porc. Un démon pour chaque porc… Oui, mais que de démons un seul humain peut entretenir en lui. Jusqu’à la désintégration.
Ce livre ouvre bien des portes et bien des perspectives, propres à chaque animal étudié. Il éclaire en particulier bien des questions que la théologie traite abstraitement ou trop techniquement. Mieux encore, la description minutieuse de ce monde animal et l’ensemble des interprétations qui en sont donné, fondée sur des analogies rigoureuses, livre une connaissance vraie de la symbolicité de l’homme, dans sa nature humaine. Et elle donne des clés précieuses et inédites « sur la vie de la psyché en son contact avec le corps et l’esprit ».
Disons-le, sur la vie de l’âme…
